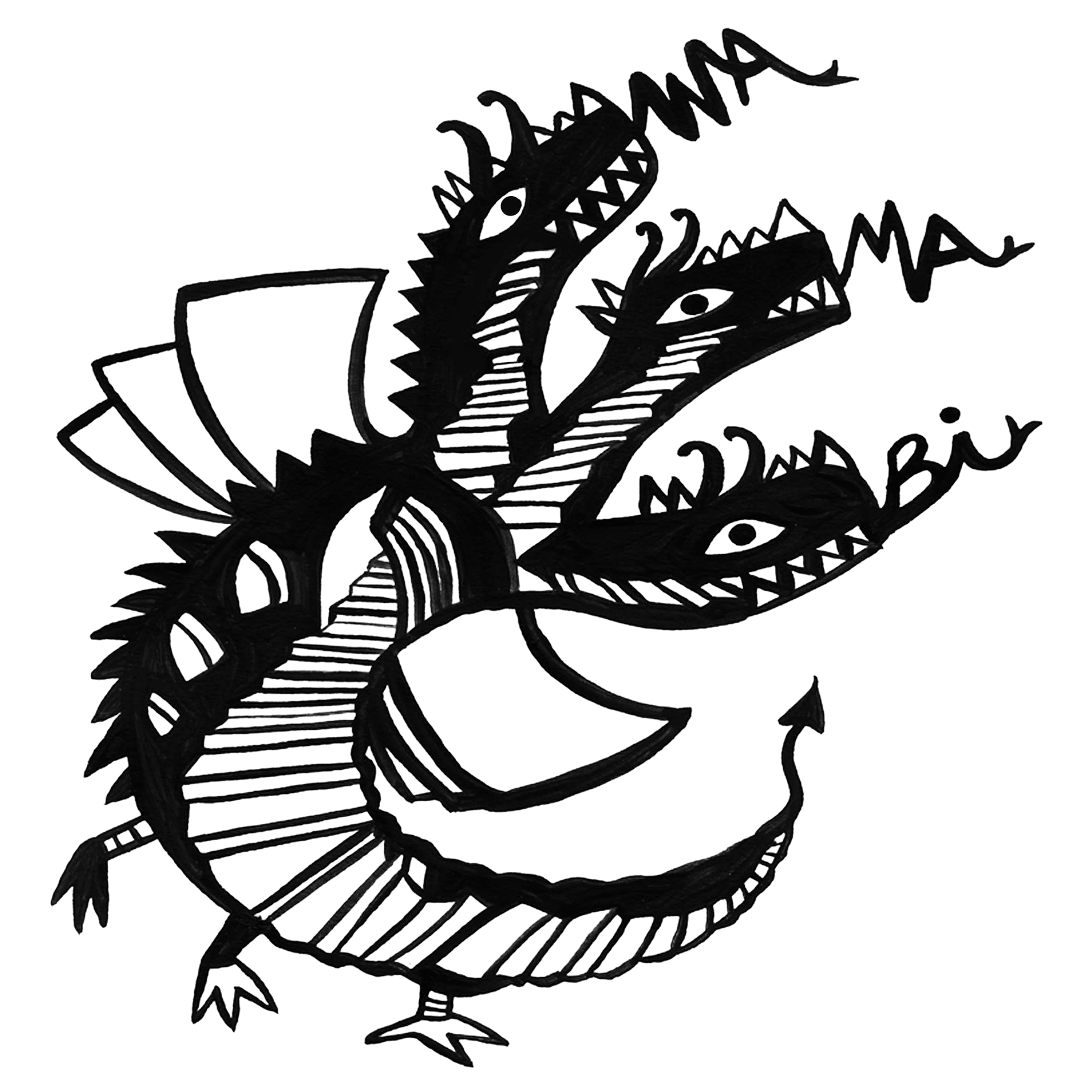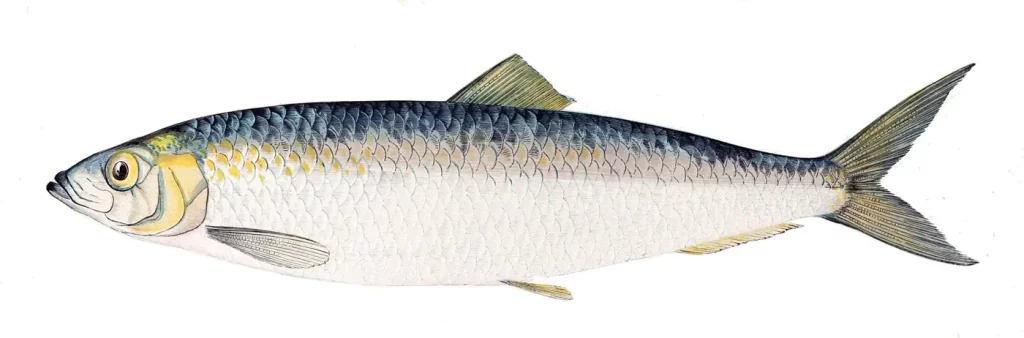Les 13 et 14 septembre 2025 auront lieu les 37e Journées du Patrimoine en Wallonie, placées cette année sous le signe du patrimoine gourmand. À Malmedy, c’est l’occasion de mettre en avant quelques spécialités locales comme le baiser de Malmedy ou le hareng.
D’autres recettes et souvenirs culinaires ont aussi été rassemblés, notamment dans le cadre du festival Nourrir autrement. Un livre de recettes participatif, disponible à la bibliothèque de Malmedy, s’enrichit peu à peu : confiture rhubarbe-orange de Marie, boulettes d’Yvette, gaufres de marraine Flore, gelée de pissenlits de Thérèse… et bien d’autres. Ce recueil en devenir n’attend plus que les contributions des habitants pour aboutir à une édition collective, témoin de la mémoire culinaire du territoire.
Le baiser de Malmedy
Le baiser de Malmedy est une petite pâtisserie composée de deux coques de meringue assemblées par une couche de crème fraîche battue et sucrée.
On doit sa création à Rodolphe Wiertz, ancien chef de l’Hôtel International de Spa vers 1880, installé ensuite à Malmedy. La spécialité bénéficia de l’essor du tourisme dans une région récemment rattachée à la Belgique. Dès les années 1920, la renommée du baiser s’inscrit dans la vague des premiers guides touristiques.
Le nom, qui nous semble aujourd’hui poétique et original, provient en réalité de l’allemand : Baiser y désigne simplement la meringue. En Wallonie, on retrouve d’autres « baisers » similaires par la forme mais différents par la recette, notamment à Gembloux, Marche-en-Famenne ou La Roche.
Pour aller plus loin :
- Dewalque Marc, « Les “baisers de Malmedy” et leur histoire », Folklore Stavelot-Malmedy-Saint-Vith, t. 49, 1985, p. 47-60.
- Dewalque Marc et Florani, Marie-Caroline, « Recettes régionales, folkloriques et alimentation populaire d’autrefois, à Malmedy ». In : De Malmedy et d’ailleurs : mélanges Albert Leloup. Bruxelles : Ministère de la Communauté française, 1994. (Tradition wallonne : 11), p. 107-116.
En 2016, la bibliothèque de Malmedy avait consacré une petite publication sur le baiser. Elle avait invité l’autrice Anita Van Belle, qui passa une partie de son enfance dans la région, à écrire une nouvelle ayant pour cadre l’ancien monastère. On y parle doublement de patrimoine gourmand, puisque la bière y est également évoquée. Cette nouvelle est disponible sur demande à la bibliothèque.
- Van Belle Anita, Le dernier virage, 2016.
Le hareng
Ingrédient typique de la salade russe, le hareng tient place particulière dans l’histoire de l’alimentation – et pas seulement à Malmedy. Il y a quelques explications à la généralisation de la consommation de harengs dans l’Europe médiévale.
La première est la christianisation. Les dogmes catholiques interdisent en effet de consommer de la viande à certaines périodes – comme le vendredi ou le Carême – et le poisson devient dès lors une chaire très prisée. Ensuite, il est très abondant – on l’appelait le « blé de la mer » au Moyen âge et son nom vient de la même racine germanique que Heer « armée » – et donc assez peu couteux.
À côté de cela, il faut ajouter que le hareng « saur » (salé puis dessalé puis fumé) peut se conserver jusqu’à trois ans.
Tout cela en faisait un aliment de choix, plus seulement pour les habitants des zones côtières, mais surtout pour une population urbaine en plein développement (XIe-XIIIe siècles) et tributaire des ravitaillements des campagnes et des aléas de la météo…
Après une période où la pêche et le commerce de ce poisson étaient régis par les Allemands de la Hanse (XIIe-XVe siècles), les Néerlandais développent une technique qui permet de préparer les harengs directement à bord des navires : le caquage. Les prix se démocratisent davantage.
Pour preuve, des fouilles archéologiques ont montré qu’à Namur, jusqu’au XVe siècle, 90 % des poissons présents sur les tables étaient des poissons d’eau douce ; ensuite, les harengs deviennent, avec les morues, les plus consommés.
Durant les siècles suivants, l’alimentation évolue avec la « découverte » de l’Amérique et ses « nouvelles » plantes (tomates, maïs, haricots, pommes de terre pour les plus connues) et aussi, à partir du XVIIIe siècle, grâce aux progrès techniques et scientifiques qui augmentent les rendements des cultures.
Il n’en reste pas moins que le hareng est resté longtemps un aliment populaire dans l’Europe du Nord – on voit des marchands de harengs ambulants à Paris au milieu du XIXe siècle – et est encore très prisé chez nos voisins des Pays-Bas – on pense surtout aux délicieux maatjes – ou d’Allemagne.
À Malmedy, l’on mange du hareng au moment du carnaval, dans la salade russe. Ô combien emblématique de la gastronomie carnavalesque, l’origine de ce plat reste cependant obscure – on cherche encore, on vous tient au courant dès qu’on aura trouvé.
On connait bien une « salade Olivier » composée en Russie dans les années 1860, devenue « salade russe » à l’étranger ; on connait aussi les salades allemandes de harengs aux betteraves et pommes de terre. Il y a sans doute un peu des deux ; mélanger des ingrédients peu couteux avec de la mayonnaise (ou assimilé) a toujours été une pratique populaire courante à la base de nombreuses recettes devenues traditionnelles.
En septembre-octobre, les sociétés locales font leur cûh’née ; elles se réunissent autour d’un plat de pommes de terre pétées accompagnées de harengs marinés et d’oignons crus.
Selon la tradition – encore dans les années 1930-40 –, on cuisait les pommes de terre tout juste récoltées dans les braises d’un feu allumé avec les plants arrachés et quelques branches « glanées çà et là » (S. Michel) et on les mangeait avec des harengs et des oignons.
Aujourd’hui, le terme désigne aussi bien le plat que la fête, l’origine du nom cûh’née vient simplement du verbe cûh’ner cuisiner.
Pour aller plus loin :
Birlouez, Éric, « Le hareng » dans La chronique d’Éric Birlouez, France Inter, 2025 : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-d-eric-birlouez/la-chronique-d-eric-birlouez-du-jeudi-07-aout-2025-7782390
Jahnke, Carsten, « Le hareng, argent de la mer » dans L’histoire, 482, 2011, p. 42-46 : https://www.webopac.cfwb.be/perioclic/details/fullcatalogue/200260499
Laget, Frédérique, « Géographie du hareng à la fin du Moyen Âge : les mers du Nord, des lieux de production ? » dans Jacquemard et al., Animaux aquatiques et monstres des mers septentrionales (imaginer, connaître, exploiter, de l’Antiquité à 1600). Anthropozoologica, 2018, 53 (6) : p. 81-86 : https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/az2018v53a6.pdf
Michel, Sylvain, Les fêtes naguère à Malmedy, 2012